|


LA
BATHYTHERMIE
 |
Exemple
de bathythermie. La propagation des ondes sonores (sonar) dans l'eau.

|
Bathythermie
? Phénomènes de réfraction quand l'onde sonore rencontre le
"dioptre" constitué par la différence de température entre deux
couches d'eau ; différence qui peut être importante en quelques mètres
seulement.
La mer n'étant
pas un milieu homogène - elle est établie par couches présentant des différences
brusque de température - les ondes sonores peuvent être déviées selon un
trajet qui trompe sur la distance et la profondeur réelle, voire parfois la
direction de l'adversaire. ( De nos jours encore, la "bathythermie"
est un problème mal résolu). Par ailleurs l'emploi du sonar en mode actif
alerte le sous-marin ennemi. On passera donc aux dispositifs permettant soit
l'emploi en mode actif, soit en écoute passive qui reste - et de très loin -
le plus utilisé.
La
bathythermie telle qu'elle est expliquée sur le FORUM de ZONE SOUS-MARINS.
(avec tous nos
remerciements à S640, S613, Z13, François, Dargaart, Pierrot, The fusible et
tous les autres...)
|
D'ailleurs une petite
question a 100 balles: 
Combien de profils bathythermiques existe-t-il? (ça conditionne l'écoute
et le moyen au submersible d'exploiter la situation tactique).
|
|
| |
Mes seuls souvenirs en matière de bathy, 3 profils :
- à gradient positif
- à gradient négatif
- mixte |
|
Pour les bathy ok,
mais il faut différencier la zone d'exercice : Méditerranée ou
Atlantique, petits fonds, talus ou grands fonds, profondeurs de la
couche (thermocline), etc. |
|
| |
Oui, bien sûr, c'est
pourquoi compte tenu de la médiocrité de mes souvenirs, je ne me suis
pas mouillé à rapprocher les profils d'un type de propagation
particulier.
Le défaut de nos bathys (avant les années 90) est qu'elles ne
portaient que sur les 300 premiers mètres (immersion), après il
fallait se fier aux abaques et au "pif", mais il est évident qu'une "mike"
avec un fond de granit à 500 m ou une vase à 3000 m, ça n'a pas le même
répondant. D'ailleurs il serait intéressant, pour la petite histoire
d'avoir une idée de la saison lors de la prise de "l'alfa" à 6500 km (
l’Alpha = SNA soviétique entendu à une distance de 6 500 km, ce qui
représente un exploit dans les anales)... |
|
La prise de contact
d'un alfa à 6 500 km, pourquoi pas, mais cela ne dit pas qu'ils aient pu
élaborer des éléments but sur ce contact.
Mais, comme je l'ai dit dans un autre message, le SLASM français nous
avait chopé à 550 km et avait donné une cinématique suffisante pour nous
envoyer un patmar (aéronef de patrouille maritime dans ce cas configuré
ASM) sur la tête! |
|
| |
Pour parler de la
bathy, je me souvient de l'écran installé au-dessus de la table à carte
(disposition existante sur les SMD type Narval dans les années 80)
et que certain appelait le bathycélérimètre et qui donnait une
photographie à un instant T de la possibilité de la propagation des
ondes sonores sous l'eau. La seule difficulté était qu’en règle générale
les couches libres se trouvaient plus basses que nos possibilité de
plonger (j'étais sur les narval à Lorient). Ce qui me fait réagir c'est
la détection d'un alpha à 6 500 km: le détecté et le détecteur s'étaient
donné rendez-vous ou quoi? Cela me semble irréaliste car dans un rayon
de 6 500 km en Atlantique, il y a énormément de monde, du monde
sous-marin (au moins une trentaine de bateaux), du monde de surface (là
on ne compte plus) et du monde civil (on compte encore moins). Je suis
plutôt de l'avis de S613, 550 km me parait être raisonnable et avec de
quoi s'en servir utilement si le bestiau se situe pas trop loin des
côtes ou tout proche d'une flotte ASM ou d'un autre sous-marin. Sinon où
est l'intérêt? |
|
Juste un petit rappel
pour fixer les esprits, l'histoire de l'Alfa ce trouve sur la page 1 du
topic "sonar" (voir le forum de ZONE SOUS-MARINS). Moi aussi, ça
m'a fait drôle grand j'ai lu ça. Mais présenté par Pepell comme ça,
pourquoi pas ! Après tout, le père clancy (En langage sous-marinier
père clancy = Tom Clancy, l’auteur d’Octobre rouge. Ndwm) nous vend
bien des détections "SOSUS" (SOSUS = barrières de microphones
sous-marins fixes installés par les américains pendant la guerre froide)
à travers tout l'Atlantique et puis d'autres sons de cloches me sont
venus pour confirmer "qu'il y avait bien eu un petit quelque chose" mais
sans précision....
Maintenant attention, avoir une détection et en tirer des éléments ça
fait 2. Comme je pense qu'on ne sera jamais affranchi des détails...
Mais à mon idée cette détection a du être confirmée par d'autres
sources. Et oui, en matière de propagation on est plus à une aberration
près ! Combien de détections non identifiées n'avons nous pas eu et
combien de fois étions-nous sourds comme des pots ? Qui se souvient d'un
certain 800 t (SMD type Daphné) de Lorient avec le périscope plié
et de son cousin Agosta à Toulon avec un périscope qui indiquait une
direction mal définie et de la filaire d'un "Narval" toulonnais ramassée
dans les hélices du "Foch". Bref ! J'arrête, car des comme ça on en a
tous 3 caisses derrière nous... Mais juste pour dire que la propagation
même si on connaît parfaitement la théorie, c'est comme la météo, il
n'arrive jamais rien de ce qui est prévu !!!!! |
|
| |
Je réponds en retard sur les types de profils
bathythermiques. Il en existe 6 en tout:
INDIA : profil isotherme en température, caractéristique de la
Méditerranée l'hiver.
MIKE : profil isotherme de la surface jusqu'à une faible profondeur, on
parle alors de chenal de surface pour cette "petite" isothermie.
CHANGE ou CHARLIE : profil MIKE avec un léger réchauffement en surface
appelé "effet d'après midi".
NOVEMBER : profil avec un gradient négatif de température en surface (
caractéristique des saisons chaudes ou des zones intertropicales).
PAPA et ANTIMIKE : ce sont des profils avec des gradients de
températures positifs en surface donc "éphémères". Ils sont
caractéristiques des zones de fonte de glace ou des sorties de grands
fleuves (Amazone, Brahmapoutre, Ganges).
|
|
Je te confirme
l'enregistrement d'un Alpha russe en essais de vitesse à la distance de
6500 km... Ca a l'air incroyable, mais les raies du réacteur étaient
caractéristiques. Par contre, à part les raies et l'azimut, la distance
exacte relève de la plus pure spéculation puisque c'est un recoupage
avec les archives de la marine soviétique (une fuite quoi, la crainte
des sous-mariniers !). Ah oui ! C'est la détection d'une oreille
américaine de poste sonar fixe en interception vers le Nord et l'Ouest
dans le Pacifique... |
|
|
Je ne
savais pas qu'on en avait sortie une nouvelle particulière à la dorsale
Atlantique ( il est question d’un profil bathythermique). Sais-tu si les
courants chauds de surface (Gulf Stream) et froid (celui du fond qui ce
déplace du nord au sud et dont j'ai oublié le nom), sont pris en compte
? |
|
Les profils
bathythermiques servent au sous-marin lors du choix de l'immersion la
plus « ad hoc » pour la détection passive et active (afin de ne pas se
faire repérer, les couches d'eau servant alors de camouflage), mais le
sous-marin doit aussi gérer sa vitesse (les auxiliaires sont bruyants),
son inclinaison, bref c’est un peu compliqué. |
|
|
Décrire des profils
types ça sert car avec un profil type on peut se représenter rapidement
les propagations.
Par exemple avec une bathy november on sait que les bruits émis en
surface vont avoir tendance à plonger (donc l'influence du type de fond
grandi) par ailleurs les rayons vont avoir tendance également à se
concentrer dans des "zones de résurgences" favorables à la détection.
Les types de bathy ne changent pas rapidement, en fait les températures
n'évoluent que lentement dans le temps par rapport aux températures de
l'air. Connaître les types de bathy est donc important pour chercher les
meilleures immersions d'écoute ou de refuge. |
Le type de profil
sert aussi, compte tenue des antécédents météo, pour la chasse en
surface.
Si tu es sur un sol océanique profond, en granit, avec peu de couches à
changement de température (mettons... au hasard... 2?), quand tu fais
mouiller un barrage de bouées en combinaison avec un sonar remorqué, tu
essais à partir du profil de propagation dans l'eau pour tenir le
contact le plus longtemps possible et tenter de voir où se trouve
physiquement le sous-marin. Un grand jeu de chat et de la souris ou le
perdant meurt... Boum ! |
|
En
effet, l'inertie thermique des mers et des océans ainsi que les
concentrations biologiques quasi constantes donnent toute leur utilités
aux bathys préprogrammées. Cela permet de ne pas foncer vers l'inconnu
et ainsi d'adapter sa stratégie en conséquence. |
|
Je
pense que le profil est différent si l'on est en zone océanique ou en
zone côtière. Quel est l'ordre de cette différence? |
|
| |
En zone côtière, une
liste non exhaustive de différences :
1. présence proche du fond donc phénomène de réflexions (fond rocheux ou
sableux plats), de diffraction (zones rocheuses), d'absorption (vases)
2. un trafic maritime nettement plus intense
3. de TRES nombreux biologiques
4. avec les courants, des effets de loupe ou de "mur" du à la suspension
dans l'eau de particules (limons aux estuaires par exemple)
5. variations de températures plus fréquentes (moins de fond = eau plus
chaude si le temps le permet ou plus froide)
6. problèmes de tenue d'immersion à cause des courants marins souvent
nettement plus gênants sur les hauts plateaux océaniques près des côtes
(j'ai un souvenir effrayant d'un enregistrement d'un SM qui se plante au
Gulf Stream) |
|
Pierrot a raison on
peut voir jusqu'a 6 types de profils mais seuls trois grands types sont
généralement modélisés avec des variantes de fonds (résurgence et ou
convergence)
la bathy India ou isocélère est caractéristique de l'Atlantique
nord en hiver 30% du temps et environs 20% du temps en méditerranée
occidentale. La couverture est uniforme avec une dispersion d'énergie.
Les sonars de coque actifs ont une bonne portée s'il existe un chenal de
surface (état de mer inférieur à 3). C'est une bathy très sensible aux
variations météo. Par vent froid elle se transforme en Papa (positive)
et par beau temps en November
la bathy november à gradient négatif très fort dans les 50 premier
mètres, 30% du temps en Atlantique et 40% en Méditerranée. Il existe une
possibilité de résurgence si le fond est supérieur a 2000 mètres et s'il
y a un excès de célérité > à 9 ms la résurgence se situe à environ 30km
en Méditerranée et 70 km en Atlantique
La bathy Mike. Il s’agit d'une couche isotherme au dessus d'une
couche à gradient négatif bathy courante 40% du temps en Atlantique
et Méditerranée, chenal de surface si l'immersion de la couche >
à 30 mètres. Il y a résurgence autour de 40km en Méditerranée et
70 km en Atlantique.
Le problème de détection
Une fois le trajet des « rayons » sonores connu, la détection est
conditionnée par le bilan énergétique dans lequel intervient les termes
suivants:
Pertes de propagation
Au cours de son trajet, l'énergie des rayons subit une atténuation due:
-à la divergence géométrique
-à l'absorption
-le cas échéant aux réflexions sur le fond et la surface.
le bruit
le bruit est tout ce qui gêne la détection. il a trois composantes:
le bruit ambiant
c'est le bruit du milieu créé essentiellement par:
le trafic maritime
le mouvement de la mer et de sa surface
les condition météo en surface, notamment la pluie
l'activité biologique.
le bruit propre c'est le bruit généré par le porteur et qui gêne
la détection:
-bruit d'auxiliaires
-bruits d'origine électrique
-bruits d'origine hydrodynamique: écoulement, cavitation, etc.
Le bruit propre augmente avec la vitesse
Le réverbéré , n'affectant que les sonars actifs. Une partie de
l'énergie émise est diffusée par l’hétérogénéité du milieu, de la
surface ou du fond et renvoyé vers le récepteur.
Ce qui donne l'équation des sonars:
SIGNAL RECU-BRUIT+GAIN>SEUIL DE DETECTION |
|
| |
Utilisation de la bathy en lutte anti navire
Principe: les prédictions de portées permettent de choisir l'immersion
du sous-marin en fonction de l'objectif recherché.
Le sous-marin utilise sa mobilité verticale pour profiter des
dissymétrie du champs sonore. Cela se traduit par le choix des
immersions suivantes:
- immersion d'approche
- immersion de franchissement de l'anneau de résurgence
- immersion de dérobement
- de même, pour la préparation de la reprise de vue, il choisit
l'immersion la plus favorable à la détection des bruiteurs.
en MIKE le sous-marin approche à grande immersion, détermine la
cinématique au-delà de la résurgence, franchit celle ci en inclinaison
nulle et le plus rapidement. Puis, redescend dans la cuvette de
non-détection. Contrôle en permanence la distance par apport à sa cible
pour ne pas retomber dans la résurgence ni s'approcher de la zone de
portée directe.
Son attaque se produit à l'immersion périscopique. Si pas de chenal de
surface, c'est favorable au sous-marin. Dérobement dans la couche.
en november l'approche et le franchissement sont identiques à
mike. Attaque à l'immersion périscopique. Très favorable au sous-marin.
Dérobement en profondeur si nécessaire.
En India la détection étant continue, l’approche se fait le plus
profond possible. L'attaque à l'immersion périscopique n'est possible
que si la mer est formée.
Voila c’est fini, j'ai quand même utilisé mes vieux cours de patron pour
ne pas raconter trop de bêtises!!!
|
|
Effectivement d'après
des études, l'influence des bathys par petit fond (<200m), devient
négligeable par rapport aux autres phénomènes. On peut citer dans
l'ordre d'importance, le type de fond, les bruits et son anisotropie
(ses variations en fonction des azimuts), l'inclinaison du fond (montant
ou descendant) avec des phénomènes de concentration de l'énergie.
D'autre part par petit fond on est souvent en présence phénomène
océanographie de petite échelle j'en citerai quelques uns:
- front thermohalin (sortie des estuaires)
- upwelling (remontée d'eaux froides du fond le long des côtes sous
certaines conditions de vent
- front de marée
- phénomène de marée interne (variation d'immersion de la thermocline
avec les mouvements de masse d'eau des marées)
- phénomènes de tourbillons (chaud ou froids)
Tous ces phénomènes ont un impact sur la bathy mais aussi sur l'activité
biologique (en général ses zones sont des zones riches en activité
biologique). Et qui dit beaucoup de poissons dit beaucoup de trafics car
beaucoup de pêchous!!! |
|
Sur une zone géographique
donnée l'environnent est le même pour tous les protagonistes.
L'aéronef dispose en des moyens suivants:
bouées passives posée en barrage sur plusieurs kilomètres, l'immersion
d'écoute est fixe ou réglable selon le type de bouée et la portée est en
fonction de la bathy.
Bouées actives, fonctionnent sur le même principe qu'un sonar de coque
d'un escorteur ASM, mais la aussi la profondeur d'émission est modulable et la
portée sujette à la bathy.
Les bouées ont une durée de vie limitée (quelques heures et non récupérables,
sauf par les pêcheurs)
Le détecteur d'anomalie magnétique (MAD) qui mesure la variation du
champs magnétique occasionné par la présence d'un sous marin sur la zone.
L'aéronef doit voler a basse altitude et ne donne qu'une indication de
présence pas de position précise.
Le sous marin doit pour éviter de perturber le champs magnétique prendre un
cap le plus près de nord magnétique possible (mais dépend de la taille du sous
marin) et ou plonger profond
Le renifleur de gaz d'échappement quand on cherche un sous marin au
schnorchel.
Le FLIR camera infrarouge qui peu détecter de jour comme de nuit un
sous marin jusqu'a 50nq (totalement passif donc très dangereux pour un
sous-marin)
Le radar à compression d'impulsion moyen quasi absolu contre lequel les
sous-marins n'ont presque aucun préavis de détection.
Les aéronefs ne cherche pas au hasard mais ont des quadrillages de zone
établis selon le type de menace et la taille géographique de la zone de
recherche.(mais cela est classifié)
Et si oui, donc la technique d'évasion pour un sous-marin serait différente
aussi, non?
Les techniques d'évasions du sous marins sont quasi identiques , mais lorsque
l'on voit un PATMAR dans le périscope il est grand temps de faire un 55 mètres
rapide avec -30 degré d'assiette!!!
|
Pour ce qui est des PM, je confirme que des zones plus ou moins larges
sont affectées et elle-même découpées en petits secteurs de recherche
d'environ 10 km sur 10 km (pour les Orion du moins, pas pour les
Atlantique mais bon, on va pas vendre la mèche !!)
Sinon, question subsidiaire, compte tenu de la différence de maniabilité
entre nos chers petits SNA et les monstres américains, je crois deviner
qui a le plus de chances d'échapper à la torpille. Quelqu'un à quelque
chose à ce sujet ?
 |
FIN
_________ _________ _________
LA
CAVITATION
| Bel
exemple de cavitation

|
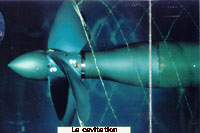 |
cavitation
= formations de cavités
remplies de vapeur ou gaz dans un liquide en mouvement
Ce mot décrit un phénomène complexe existant sur les hélices des sous-marins.
 |
CAVITATION
La
cavitation décrit le phénomène d'oscillation radiale d'une bulle de gaz
et/ou vapeur dans un liquide. Historiquement, le problème remonte à l'érosion
des hélices de bateau, dont Lord Rayleigh (qui a donné son nom à une équation
différentielle régissant le mouvement) a montré qu'elle était due à la
formation et croissance explosive de bulles de vapeur en présence d'une dépression
(résultant d'un effet Bernoulli), suivie d'une implosion violente. Une telle
implosion, souvent supersonique, peut engendrer une onde de choc sphérique
dans le liquide, ainsi que des jets de liquides en présence d'une paroi
solide.
|
| Parallèlement
à cette "cavitation hydrodynamique", la dépression responsable de
la croissance explosive de la bulle peut être provoquée par un champ
acoustique de forte puissance (provoquant des pressions négatives dans la
phase de raréfaction). On parle alors de cavitation acoustique. |
 Cavitation à bulles
Cavitation à bulles
|
 Cavitation à poches
Cavitation à poches |
Comment
repousser les limites de fonctionnement des pompes, turbines, hélices de
navire ou de sous-marin, moteurs cryogéniques de fusées... sans contraindre
le liquide qui les traverse à se rompre, "à caviter" ?
Pourquoi un liquide qui coule trop vite se fracture-t-il en donnant naissance
à des cavités gazeuses ? Comment prévoir et maîtriser les conséquences néfastes
qu’engendre le développement de la cavitation dans les installations
hydrauliques ? Comment une simple bulle de vapeur peut-elle, en implosant,
endommager les matériaux les plus résistants ? Voila les questions qui
se posent lors de la construction d'un bateau.
|
 |
 Cavitation à tourbillons
Cavitation à tourbillons
|
En
hydrodynamique navale, la cavitation altère les performances des systèmes
propulsifs induit des vibrations, provoque l'érosion des parties tournantes et
rayonne du bruit qui pénalise la discrétion acoustique d'un bateau. Les
recherches sur la cavitation doivent permettre d'augmenter les performances des
propulseurs et de limiter les effets indésirables de la cavitation. Parmi les
différents types de cavitation qui peuvent exister sur une hélice, l'action de
recherche s'intéresse à une étude de la cavitation par poche attachée se développant
sur des surfaces portantes. Actuellement, la recherche est orientée vers l'étude
du comportement instationnaire des poches. Ce comportement très pénalisant en
termes de bruit, de vibration et d'érosion, est encore mal connu. Pour mener
ces études, un profil d'aile a été spécialement fabriqué. Il est équipé
d'un réseau de capteurs de pression pariétaux permettant d'analyser la
structure spatio-temporelle des poches de cavitation. Ces études sont couplées
à celles des coefficients hydrodynamiques qui permettent d'analyser l'influence
du caractère instationnaire des poches sur les performances hydrodynamiques du
plan porteur.
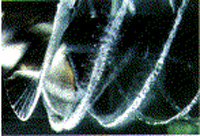 Un
mélange des trois CAVITATIONS. Un
mélange des trois CAVITATIONS.
 |
La pompe
hélice carénée des SNLE NG français. |
|

|
SNA type RUBIS
 |
|

Sonar et sondeur |
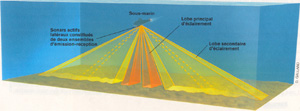 |

|